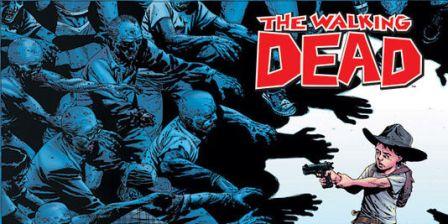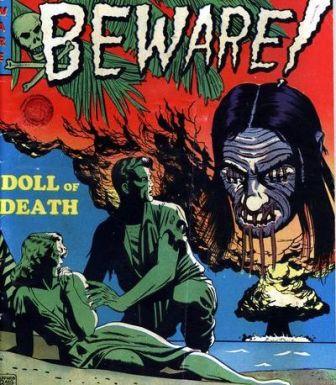Nous voici au sixième et dernier acte de ce débat théâtralisé consacré aux premières approches du calcul, en maternelle et au CP. Débat bien réel, puisque dans cette série, les commentaires précédemment laissés sur ce blog par des lecteurs (au point d’en faire un véritable fil de discussion) remontent au premier plan pour fournir la matière des billets.
Débat d’experts? Débat abscons? Oui et non. Oui, car ces échanges, sur des sujets qui terrorisent les littéraires, ne sont «parlants» que pour des professionnels motivés. Non, car ils n’exigent tout de même pas d’avoir fait Polytechnique, portent sur les débuts de la scolarité et s’imposent au moment où les programmes sont remis en chantier.
Une fois le rideau tombé, une nouvelle étape de mise en scène serait encore nécessaire d’un point de vue de technique journalistique: reprendre l’ensemble de ces échanges encore bruts et en travailler un «digest» facilement accessible. J’espère avoir le temps de le réaliser.
Cet acte commence par un texte de Rémi Brissiaud auquel celui-ci accorde une valeur importante dans le débat sur les futurs nouveaux programmes. C’est un thème sur lequel il est «monté au créneau» ces dernières semaines, notamment par des contributions au Café pédagogique, où il ferraille avec les tenants de l’«evidence based education», la tendance à succès du moment qui prétend simplifier les décisions de politique éducative.
Ici, évidemment, ce chercheur a des contradicteurs… qu’il contredit à son tour, etc. Le «dernier mot» sera donc le résultat d’une coupure arbitraire. D’autant que certains ont déjà repris le débat en commentant à nouveau chacun des actes de cette série, qu’il est toujours possible, en cliquant ici, de prendre à partir du début.
Le rideau bouge. Place aux arguments.
Luc Cédelle
Acte 6
Où l’on accourt pour se quereller aimablement sur l’usage cardinal et l’usage ordinal des nombres

Acte 6. Scène 1. Rémi Brissiaud à tous
À Michel Delord et à bien d’autres, j’espère…
[Rappel du blogueur : Michel Delord ancien professeur de mathématiques dans le secondaire, a été à l’origine de la création du GRIP (Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes), dont il n’est plus membre. Rémi Brissiaud est chercheur en psychologie cognitive au laboratoire Paragraphe à l’université de Paris 8 et auteur de manuels. Depuis le début de ce fil de discussion, Michel Delord et Rémi Brissiaud en sont les contributeurs les plus opiniâtres.]
J’avais survolé votre texte il y a quelques mois et il m’avait laissé dubitatif parce que vous y mélangiez des propos concernant l’articulation entre les notions de nombre cardinal et de nombre ordinal avec d’autres qui concernaient vos rapports avec le GRIP. J’aimerais que cet écrit n’apparaisse partisan dans aucune polémique et je m’intéresserai seulement à cette question qui concerne les apprentissages numériques à l’école : quel usage des mots «nombre », « cardinal » et « ordinal » faut-il recommander aux chercheurs et aux enseignants ?
Il est d’autant plus important de répondre à cette question que, comme nous allons le voir, cela éclaire les enjeux d’un débat qui se joue actuellement dans la commission de rédaction des futurs programmes pour l’école maternelle : faut-il redonner aux enseignants de Grande Section la liberté de n’aborder que les 10 premiers nombres à l’école maternelle ?
Le nombre est nombre, indistinctement cardinal et ordinal
Vous dites que le nombre à l’école primaire est à la fois cardinal et ordinal. Il me semble qu’il faut être plus précis : il est indistinctement cardinal et ordinal. En effet, cette nuance a des conséquences importantes. Pour les lecteurs non mathématiciens, il faut signaler qu’il s’agit là d’une vérité mathématique : à l’école les nombres sont finis ; or, c’est seulement lorsqu’on s’intéresse à des ensembles infinis qu’on arrive à dénicher des ordinaux qui ne sont pas des cardinaux. Lorsqu’on reste dans les ensembles finis, donc, le nombre est nombre, indistinctement cardinal et ordinal. Parler de « nombre cardinal » ou de « nombre ordinal » n’apporte aucune information de plus que lorsqu’on parle de « nombre » et, donc, l’emploi de ce mot « nombre », sans aucun qualificatif, est préférable parce que dans une démarche de théorisation, il vaut mieux s’abstenir d’utiliser des mots qui ne servent à rien.
En revanche, les nombres ont deux grands usages : la mesure des grandeurs (les collections seront considérées ici comme des grandeurs) et la représentation des rangs. Souvent, on parle d’usage cardinal du nombre lorsqu’il sert à mesurer des grandeurs et d’usage ordinal lorsqu’il sert à repérer un rang. On comprend bien ce que signifient ces deux expressions : usage cardinal et usage ordinal des nombres. Dans cet emploi, les mots « cardinal » et « ordinal » permettent de référer à deux entités bien distinctes : les contextes correspondants, et on ne peut guère s’en passer.
D’un point de vue pédagogique ou didactique, les grandeurs (usage cardinal) et les rangs (usage ordinal) doivent-ils être mis sur le même plan ? La réponse est assurément non, pour une raison bien simple : alors qu’il n’y a pas de mesure des grandeurs efficace sans nombres, le repérage des rangs peut se faire dans la plupart des contextes à l’aide de simples numéros, c’est-à-dire avec des entités qui ont bien moins de propriétés que les nombres. Et c’est là que s’introduit un troisième concept, indispensable, et qui doit être distingué des deux autres : celui de numérotation.
La numérotation suffit la plupart du temps pour repérer les rangs
Souvent, on comprend mieux les choses quand on change de système de notation parce que cela permet de prendre conscience de ce qui dépend des symboles employés et ce qui est intrinsèque aux concepts. Les symboles utilisés pour numéroter les éléments d’une liste peuvent être divers et ils dépendent évidemment de la taille de l’ensemble correspondant : système utilisé dans les hôtels (chambres 101, 102…, 201, 202…), lettres de l’alphabet munies de l’ordre alphabétique, etc. Les lettres conviennent particulièrement bien pour les ensembles de petite taille, elles sont d’ailleurs d’un usage courant. On les trouve par exemple dans les théâtres, quand, dans chaque rangée, les fauteuils sont numérotés : A, B, C…
Un numéro n’est pas un nombre parce qu’il est clair qu’un numéro ne véhicule pas nécessairement l’idée de la pluralité correspondant à l’ensemble des numéros jusqu’à lui : lorsqu’on a la chambre d’hôtel « 407 », par exemple, on ne sait pas combien il y a de chambres jusqu’à la nôtre mais cela ne gêne en rien. Même dans les contextes où tous les numéros sont alignés dans l’ordre, comme celui d’un théâtre dont les sièges sont numérotés avec des lettres, les numéros n’ont pas les propriétés des nombres : sachant que « j’ai le siège R », par exemple, je n’ai nullement besoin de penser à la pluralité correspondante pour retrouver mon siège. Nous sommes d’ailleurs complètement incapables de répondre de manière précise à la question : « C’est combien R ? ». Pour répondre, il faudrait définir R à l’aide d’un rang plus petit qui sert de repère, le rang correspondant à 10, par exemple. Or, nous ne disposons pas d’un tel repère. Peu importe d’ailleurs, parce que cela ne nous empêche nullement de retrouver notre siège. Les numéros n’ont pas les propriétés des nombres mais ils remplissent plutôt bien leur rôle.
La numérotation ne conduit pas au nombre
Il faut l’affirmer : il est impossible de passer des numéros aux nombres sans transiter par un contexte cardinal parce que l’intelligence des nombres résulte de la maîtrise des relations construites à partir des actions d’ajout et de retrait dans un contexte cardinal. Pour en prendre conscience, il suffit d’imaginer que dans la situation des sièges de théâtre, on décide de remplacer les lettres par les écritures chiffrées habituelles. Quelles conséquences cela a-t-il ? En remplaçant la lettre R par l’écriture chiffrée 18, on ne fait pas que remplacer un système de numérotation quelconque par un autre, parce que le système des écritures chiffrés est un système numérique, c’est-à-dire un système de numérotation « extra-ordinaire » qui est bien plus informatif qu’un système de numérotation « ordinaire » : quand on est passé devant le siège 6, par exemple, on était au tiers du chemin vers le 18 ; quand on est passé devant le siège 9, on était à mi-chemin ; quand on est passé devant le siège 10, on était à 8 rangs de celui visé ; quand on est passé devant le siège 15, on en était à 3 rangs, etc. On aurait été incapable d’accéder à de telles connaissances avec les numéros que sont les lettres F (6), I (9), J(10) et O (15) respectivement. En remplaçant un système de numérotation quelconque par un autre qui, lui, est numérique, on récupère toutes les connaissances numériques que ce dernier véhicule.
Or, on n’a jamais vu quiconque acquérir l’intelligence des nombres, c’est-à-dire la connaissance de telles relations, en apprenant à maîtriser, au sein d’un système de numérotation, les relations entre chaque élément et son successeur, le successeur de son successeur, etc. Il y a de bonnes raisons pour cela : la commutativité, par exemple, signifie dans un contexte ordinal que le xème élément après le yème est aussi le yème après le xème. Il existe de nombreux contextes cardinaux dans lesquels la commutativité est presque évidente : lorsqu’on réunit une équipe de garçons et une équipe de filles, a-t-on ajouté les filles aux garçons ou les garçons aux filles ? Appliquée aux rangs, la commutativité n’est jamais évidente. Il faut se l’approprier dans un contexte cardinal avant d’être convaincu que, dans un contexte ordinal, ça marche encore. Ainsi, le nombre est nombre avant d’être utilisé dans un contexte ordinal et il se construit nécessairement dans un contexte cardinal.
La numérotation permet de réussir sans mobiliser les « vrais nombres »
De tout temps aux États-Unis et depuis 1986 en France, une file des écritures chiffrées est affichée dans pratiquement toutes les classes de GS, de CP et de CE1. Elle est souvent au-dessus du tableau. Or, on dispose de nombreuses preuves du fait que cette file fonctionne comme une file numérotée dans la tête des enfants : lorsqu’on demande à un enfant de montrer 18, par exemple, il montre la case 18, c’est-à-dire le numéro. Il ne pense pas aux pluralités que constitueraient 18 pommes, 18 chaises, 18 pigeons…, ni même, souvent, à la pluralité que constituent les 18 premières cases.
Et dans presque toutes les méthodes de CP, cette file numérotée est utilisée afin que les élèves apprennent à donner le résultat d’une addition quelconque : 18 + 3 = …, par exemple. Pour prendre conscience de ce que les élèves apprennent et de ce qu’ils n’apprennent pas avec les leçons correspondantes, il est intéressant de poursuivre notre simulation en imaginant que le matériel utilisé est une file numérotée avec les lettres de l’alphabet, et qu’il s’agit de calculer R + C = …, c’est-à-dire l’écriture qui correspond à 18 + 3 = … dans notre simulation. En effet, cette situation d’usage d’une file numérotée avec des lettres est celle d’un élève qui, face aux écritures chiffrées, ne connaît aucune des relations numériques évoquées précédemment (18, c’est 2 fois 9, c’est 10 plus 8, c’est 15 + 3, etc.). Les élèves qu’on qualifie souvent de « fragiles » sont, devant la file des écritures chiffrées, comme nous sommes devant la suite des sièges d’un théâtre.
Décrivons ainsi cette leçon sur l’addition, sachant, évidemment, que dans la réalité de la classe, les numéros sont donnés sous forme chiffrée. Pour compléter R + C =…, l’enseignant demande aux élèves de mettre le doigt sur la case R (ce sera la case de départ) et il continue ainsi : « Avec le doigt, on part de la case R et on va se déplacer de C cases vers la droite. Il faut dire A au-dessus de la case suivante (la case S), dire B au-dessus de la suivante (la case T) et enfin C au-dessus de la suivante (la case U) ». Les élèves ont alors le doigt sur la case U, celle d’arrivée. L’enseignant dit aux élèves que c’est le résultat cherché et il leur demande de compléter l’égalité avec ce qui est écrit dans cette case : R + C = U. Plusieurs exemples sont traités et ça y est, les élèves savent ce qu’il faut faire pour compléter une « addition ».
Le mot « addition » vient d’être mis entre guillemets parce que, malheureusement, même si cette égalité ressemble à une addition, il est probable que l’idée d’ajout aura été totalement absente de la tête de nombreux élèves. Par ailleurs, dans la réalité de la classe, cette leçon aura conduit les élèves à écrire : 18 + 3 = 21 (21 correspond à U, évidemment) mais, de même que l’évocation des « vrais nombres » correspondants à R et U, n’est d’aucune façon nécessaire pour compléter R + C =…, l’évocation des « vrais nombres » correspondants à 18 et 21, est superflue pour compléter de cette manière : 18 + 3 = …
Suite à une telle leçon, les élèves deviennent capables de donner les bonnes réponses en utilisant la « recette » qu’on leur a montrée (repérer la case de départ, etc.), recette qui porte sur des numéros, alors que dans leur tête, ils ne mettent pas en relation des pluralités (des « vrais nombres »), ils ne calculent pas. Le plus grave est que, comme ils donnent les bonnes réponses, personne ne s’inquiète du fait qu’ils ne maîtrisent pas les relations numériques nécessaires (18, c’est 2 fois 9, c’est 10 plus 8, c’est 15 + 3, etc.) Personne : ni l’enseignant, ni les parents, ni les enfants eux-mêmes évidemment.
La suite est connue : les élèves donnent les bonnes réponses mais ils ne progressent pas comme ils devraient ; comme ils ne mettent pas en relation des pluralités, ils ne mémorisent pas les relations correspondantes, ils ne mémorisent pas les résultats d’additions élémentaires et restent prisonniers de la numérotation. Ce sont, comme disait Henri Canac, des « élèves mal débutés » qui ne mémorisent pas les résultats d’additions élémentaires. La plupart du temps, cependant, c’est l’étiquette d’ « élèves peu doués », voire « dyscalculiques » qui, vers le CE2, leur est apposée.
La numérotation « empêche de penser, de calculer »
Les pédagogues qui se sont le mieux exprimés concernant la numérotation sont certainement les époux Fareng, en 1966 (ils étaient conseillers pédagogiques d’une des grandes inspectrices générales des écoles maternelles, Madame Herbinière-Lebert). Ils écrivaient :
« … cette façon empirique fait acquérir à force de répétitions la liaison entre le nom des nombres, l’écriture du chiffre, la position de ce nombre dans la suite des autres, mais elle gêne la représentation du nombre, l’opération mentale, en un mot, elle empêche l’enfant de penser, de calculer ».
Cette citation est remarquable parce que dans le même temps qu’elle souligne les progrès à court terme que permet la numérotation, elle en note les limites concernant les progrès à long terme. Je pense avoir montré dans mon dernier petit ouvrage que tous les faits empiriques concordent : qu’on fasse appel aux résultats d’enquêtes en sociologie de l’éducation, à l’histoire des discours et des pratiques scolaires, à la psychologie des apprentissages numériques, à la psychologie clinique, à la psychologie interculturelle, dans tous les cas, les résultats disponibles concordent avec la thèse d’un effet délétère à long terme de l’enseignement de la numérotation.
Après 1986, date des premières instructions officielles concernant l’école maternelle qui recommandent d’apprendre la suite des noms de nombres comme une suite de numéros, l’usage de la numérotation s’est rapidement généralisé à l’école maternelle. Les progrès à court terme que la numérotation permet, expliquent ce phénomène : il est difficile aux enseignants de résister à ce qui apparaît comme des succès pédagogiques à portée de main.
Il faut aujourd’hui permettre aux enseignants de différencier l’enseignement de la numérotation de l’enseignement des nombres. Il est facile d’enseigner la numérotation jusqu’à 30 et même au-delà à l’école maternelle. Il est difficile d’enseigner les nombres jusqu’à 10 à l’école maternelle. Un enjeu crucial de l’élaboration des prochains programmes sera d’obtenir qu’ils spécifient explicitement que les enseignants ont dorénavant la liberté de n’aborder que les 10 premiers nombres à l’école maternelle, lorsqu’ils font le choix d’enseigner les nombres et pas seulement les numéros. Il faut dire explicitement aux enseignants qu’ils ont la possibilité de renouer avec la culture pédagogique qui, vers 1950, était celle de l’« Éducation nouvelle » avec des personnalités comme Gaston Mialaret, Henri Canac, etc.
PS1 : On trouve dans mon dernier ouvrage une sorte d’autocritique : en 1989, je mettais en garde contre l’emploi d’une file numérotée mais j’essayais également d’en aménager l’usage pour le sauver (repère 10, curseur qui sépare les cases plutôt que les entourer…). Aujourd’hui je considère que les procédés précédents sont vains.
PS2 : En mathématiques, numéroter un ensemble, c’est le munir d’une structure de « bon ordre ». En fait, le même contenu que celui abordé dans ce texte, se trouve, en plus matheux (je parle de morphisme !) mais avec certaines formulations moins précises (on s’améliore !) dans un compte-rendu de mon intervention au séminaire national de didactique des mathématiques de mars 2013 (bientôt sur le site de l’ARDM).
PS3 : Le concept de « numérotation » n’émerge pas dans la littérature scientifique internationale parce que le mot « numéro » n’a pas d’équivalent en anglais (number signifie à la fois nombre et numéro). Il faut profiter de la chance que nous offre la précision de notre langue.
Rédigé par : Brissiaud Rémi | le 17 mars 2014 à 12:36 |
Acte 6. Scène 2. Rudolf Bkouche à Rémi Brissiaud
[Rudolf Bkouche, mathématicien, professeur émérite à l’Université de Lille 1, spécialiste de l’épistémologie et de l’histoire des mathématiques. Présentation plus complète dans l’Acte 1.]
Monsieur Brissiaud,
Sous prétexte de mettre de l’ordre, vous mélangez beaucoup de choses. En distinguant avec raison le nombre et le numéro, vous oubliez que pour dénombrer on compte, que dans la comptine qui accompagne le comptage, les nombres ne sont pas des numéros, mais des nombres. Je parle de compter des objets en utilisant la comptine, non de réciter la comptine pour elle-même.
D’accord avec vous pour dire que réciter la comptine indépendamment du comptage n’est pas compter, mais vous oublier le rôle de la comptine dans l’acte de compter.
Je comprends qu’on veuille mettre de l’ordre dans ces connaissances, mais la mise en ordre n’est pas une simple formalité, c’est un approfondissement des connaissances. Ce qui vous dérange c’est l’aspect empirique du comptage dans lequel se mêlent diverses opérations. Mais peut-on éviter ces aspects empiriques.
Quant à la distinction cardinal/ordinal, elle commence bien avant l’étude de l’infini et de la théorie des ensembles, mais c’est peut-être d’abord une distinction langagière qui relève de la grammaire.
Par contre, quand on compte, les deux notions s’entremêlent, mais peut-on faire autrement. Avant de parler de l’ensemble des nombres, notion née à la fin du XIXème siècle, on parlait de la suite des nombres, ce qui mélange cardinal et ordinal. Est-ce grave ?
Ce qui vous reste de la réforme des mathématiques modernes, c’est de penser que pour apprendre et pour comprendre, il faut connaître les fondements de ce qu’on apprend ; non seulement une erreur pédagogique, mais une erreur épistémologique. L’activité scientifique nous apprend qu’on fonde après coup, pour mettre de l’ordre dans ses connaissances. Si on commence par fonder, on risque, comme le rappelle Bachelard, de ne jamais bâtir. Et même si cela se passe différemment dans l’enseignement, on a le même problème. Il faut prendre en compte le fait que l’apprentissage ne peut se passer des ruptures nécessaires. On peut attendre que la connaissance des nombres évolue au cours de l’apprentissage.
Rédigé par : rudolf bkouche | le 17 mars 2014 à 17:04 |
Acte 6. Scène 3. Rémi Brissiaud à Rudolf Bkouche
Monsieur Bkouche,
Quand vous dites : « Quant à la distinction cardinal/ordinal, elle commence bien avant l’étude de l’infini et de la théorie des ensembles, mais c’est peut-être d’abord une distinction langagière qui relève de la grammaire. », vous avez raison et votre propos est très proche du mien : la distinction n’est pas mathématique, elle renvoie à deux types de situations différentes (mesure des grandeurs et représentation des rangs) mais aussi à deux façons de s’exprimer : les quatre lapins vs. le quatrième lapin ou le lapin numéro 4 (en contexte ordinal, on s’exprime d’une façon ou de l’autre).
Quand vous dites : « Ce qui vous dérange c’est l’aspect empirique du comptage dans lequel se mêlent diverses opérations. », j’avoue que je ne comprends pas. Je recommande de ne pas enseigner le comptage comme un numérotage : « le un, le deux, le trois, le quatre », mais de l’enseigner comme un dénombrement : « un ; et encore un, deux ; et encore un, trois ; et encore un quatre ». Expliquez-moi en quoi une façon de s’y prendre serait plus ou moins « empirique » que l’autre. Franchement, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Quand je compare les deux façons d’enseigner précédente, la seconde est, pour moi, plus explicite que la première. Êtes-vous en train de suggérer qu’il faudrait s’y prendre de la première façon, afin de créer un obstacle à la compréhension des élèves pour qu’ultérieurement ils puissent mieux surmonter cet obstacle ? Êtes-vous sûr que c’est ce que Gaston Bachelard a essayé de nous dire ?
Bien cordialement,
Rédigé par : Rémi Brissiaud | le 18 mars 2014 à 15:09 |
Acte 6. Scène 4. Rudolf Bkouche à Rémi Brissiaud
Monsieur Brissiaud,
Je ne comprends pas votre distinction entre le comptage-numérotation et le comptage dénombrement. Pour dénombrer une collection d’objets on compte, c’est-à-dire qu’on dit la suite des nombres, la comptine. Je ne vois pas comment faire autrement. Je ne propose donc ni la première façon, ni la seconde façon, une distinction qui n’a pas lieu d’être mais que l’on peut expliciter une fois que les élèves savent compter.
Bien cordialement
Rudolf
Rédigé par : rudolf bkouche | le 18 mars 2014 à 21:52 |
Acte 6. Scène 5. Rémi Brissaud à Rudolf Bkouche
A M. Bkouche,
Sauf que les mots réfèrent ! Quand vous prononcez un mot devant un jeune enfant en utilisant un pointage du doigt, la signification qu’il va attribuer au mot, dépend de ce que vous pointez.
Imaginez des jetons, 5 par exemple, que vous allez compter en les déplaçant du bord de la table vers son centre. Il n’y a qu’une façon de commencer : vous dites « un » en déplaçant un jeton. Pour continuer, il y a deux possibilités de coordination entre le pointage du doigt et la prononciation du mot « deux » :
– Soit vous dites « deux » dès le moment où vous posez le doigt sur le jeton, c’est-à-dire avant qu’il soit déplacé, et l’enfant comprendra que vous allez déplacer un jeton qui s’appelle « le deux ».
– Soit vous ne dites « deux » qu’après que le jeton ait été déplacé, c’est-à-dire après que la collection de deux jetons ait été formée. Et l’enfant comprendra que lorsqu’on ajoute un jeton à un autre jeton, on forme une collection de deux jetons.
Les deux mêmes possibilités existent avec les jetons suivants, évidemment. La première façon de faire correspond à ce que j’appelle l’enseignement d’un comptage-numérotage, la seconde est une tentative d’enseignement du comptage-dénombrement.
Et l’enseignement du comptage-dénombrement peut être plus explicite (i.e. « portée par le langage ») : il suffit de dire : « Un », « Et encore un, deux », « Et encore un, trois », « Et encore un, quatre », « Et encore un, cinq ». Je vous laisse imaginer ce que fait le doigt au moment où chacun des noms de nombres précédents sont prononcés.
Comme je dis aux enseignants de maternelle dans les situations de formation que j’anime : c’est un métier compliqué que vous faites.
Rédigé par : Remi Brissiaud | le 20 mars 2014 à 11:50 |
Acte 6. Scène 6. Catherine Huby à Rémi Brissiaud
[Note du blogueur: Catherine Huby est membre du GRIP et auteur de manuels d’apprentissage de la lecture édités par cette association. Pour la situer, elle est l’auteur du texte « Mon métier à moi, c’est maîtresse d’école », publié en billet sur ce blog . L.C.]
Je pense que M. Brissiaud veut dire qu’il ne s’agit pas de comptage au sens où nous l’entendons.
Ces enfants qui ont appris trop tôt à chantonner « undeuxtroisquatcinq… » comme naguère d’autres psalmodiaient « jevoussalumaripleinedegrace » n’ont jamais pu faire la « bascule » entre cette première chanson apprise avec peine (mon petit-fils, tout juste trois ans, en est à « un deux trois sept huit sept huit sept huit »).
Comme de plus à cette chansonnette, moins drôle que le « Un deux trois, j’irai dans les bois… » de notre enfance, on leur a ajouté la reconnaissance de signes aussi abscons pour eux que les caractères des mantras que lisent les moines tibétains pour nous, cette chanson a encore moins de sens (imaginez mon petit bonhomme qui tape sur la file numérique et dit certes un, deux, trois en montrant1, 2, 3 mais dit sept, huit, sept, huit, sept, huit en montrant 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Enfin, comme la décomposition de ces nombres, ce que fait spontanément le tout-petit que je viens d’évoquer en dépliant ses doigts : « Moi, je veux un, et un, et un, et encore un. Je veux tout ça ! », nos élèves de six ans (et même parfois sept) en sont encore à chantonner leur « jevoussalumari » d’un nouveau genre pour savoir dire combien mon petit-fils d’à peine trois ans veut de cailloux pour lancer dans le ruisseau.
Rédigé par : Catherine Huby | le 20 mars 2014 à 08:03 |

[Récapitulatif du blogueur. Ces échanges, partiels, momentanés, confinés à un espace médiatiquement modeste, représentent une heureuse exception. Il est extraordinairement difficile, dans l’éducation nationale, de débattre du moindre point d’organisation ou de méthodologie scolaire en dehors des dialogues de sourds où chaque argument n’est pas jugé en lui-même mais par rapport à sa provenance: ami, ennemi, ami de mes ennemis, ennemi de mes amis…? N’en concluons pas pour autant, selon un cliché convenu et pas toujours innocent, qu’il faut jeter « l’idéologie» à la rivière pour se livrer à une science prétendue impartiale. « L’idéologie», comme la « pensée unique», sont des expressions qui servent à désigner les idées des autres. Et «la» science, surtout dans un domaine aussi complexe que l’éducation, est tout ce qu’on veut sauf unanime et neutre. Mais sur des sujets délimités, dans le cadre de valeurs partagées, au sein d’une même institution et d’une communauté professionnelle s’inscrivant dans sa logique, la confrontation d’arguments rationnels est une nécessité. A travers cette série d’échanges, on voit néanmoins émerger ou réapparaître une réalité aussi embarrassante pour les protagonistes eux-mêmes, qui aimeraient emporter les convictions, que pour les politiques toujours à l’affût, ce qui est bien compréhensible, de la «décision claire et efficace»: le consensus souhaité, rassurant, soulageant, se dérobe sans cesse. Qu’il s’agisse de la lecture – un débat en train de revenir au premier plan – ou comme ici du calcul, la recherche de la bonne façon de faire, rationnellement étayée et loyalement évaluée, reste un chantier à peine ébauché. Et il est fort possible qu’un pluralisme des approches et des pratiques soit la seule solution. Encore faudrait-il que toutes les écoles de pensée en présence acceptent de jouer le jeu de la confrontation méthodique au lieu de se reposer sur la communication, le lobbying et l’argument d’autorité. Ce n’est pas encore le cas. C’est aussi le rôle des médias, grands ou petits, de les y inciter… L.C.]

Pour revenir à l’Acte 1, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 2, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 3, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 4, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 5, cliquer ici
 Véronique Decker, professeure des école, directrice de l’école Marie-Curie à Bobigny (Seine-Saint-Denis) est pour moi une interlocutrice de longue date. En ce moment, je publie avec elle un blog « Dix ans d’école au pîed des tours », constitué de récits sur son école et son vécu de directrice.
Véronique Decker, professeure des école, directrice de l’école Marie-Curie à Bobigny (Seine-Saint-Denis) est pour moi une interlocutrice de longue date. En ce moment, je publie avec elle un blog « Dix ans d’école au pîed des tours », constitué de récits sur son école et son vécu de directrice.