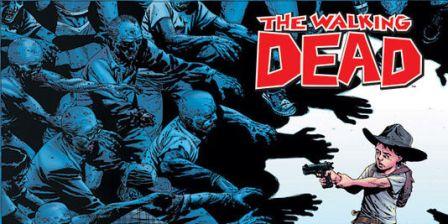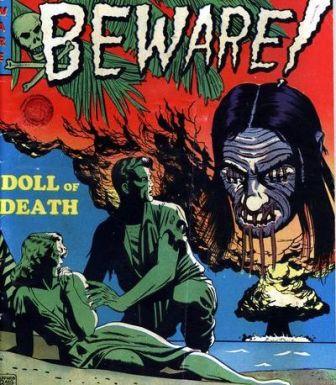Quatrième acte, sur six, de cette petite série de théâtre informatif, bâtie sur le principe du blog inversé, où les commentaires remontent au premier plan pour fournir la matière d’un billet. D’accord, je concède un aspect théâtre d’avant-garde pour public éclairé et patient…
C’est aride, mais l’information est là! Ne serait-ce que grâce à la qualité du matériau initial. Le débat porte sur les premières étapes de l’apprentissage du calcul. Depuis l’acte 1, le lecteur/spectateur a déjà eu l’occasion d’apprendre certaines choses sur les termes de ce débat et ses enjeux au moment où est mise en chantier l’élaboration de nouveaux programmes.
Ce qui est abordé ici a des conséquences avec de «vrais» élèves. Nous allons cette fois plonger dans le parcours professionnel d’une maîtresse d’école passée en quelques décennies d’exercice de l’obéissance naïve, appliquant les nouveautés avec enthousiasme, à une sorte de dissidence tolérée. Transition lente qui permet de bien réaliser quelle est la vraie durée et donc la portée des décisions prises en matière scolaire.
Nous verrons comment certains collègues, experts ou chercheurs réagissent à son récit, et comment elle réagit en retour. Bref, les protagonistes continuent de discuter ferme et – c’est un des intérêts de ce dialogue – dans un cadre informel qui déborde les frontières habituelles de l’officialité comme celle des « chapelles» de l’éducation.
Luc Cédelle
Acte 4
Où l’on voyage depuis l’étrange époque du «no number» jusqu’aux satisfactions et aux incertitudes de l’expérimentation

Acte 4. Scène 1. Catherine Huby à Rémi Brissiaud, …
[Rappel du blogueur: Rémi Brissiaud est chercheur en psychologie cognitive au laboratoire Paragraphe à l’université de Paris 8 et auteur de manuels. Catherine Huby, maîtresse d’école dans la Drôme, est membre du GRIP (Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes).]
Bonjour,
Interpellée par M. Brissiaud via Guy Morel, plutôt que de répondre par une dispute pédagogique in abstracto, j’ai préféré rédiger ce qui suit.
Cordialement,
C. Huby
En novembre 1975, titulaire d’un bac D et ayant échoué de peu à l’oral du concours d’entrée à l’École Normale de Valence, dans la Drôme, j’ai été recrutée sur la liste complémentaire et envoyée dans des classes, après deux semaines de stage, pour y effectuer des remplacements.
Parallèlement à cette fonction de remplaçante, j’ai étudié pendant deux années, au rythme d’un mercredi de formation par mois, sous la houlette d’un IDEN (Inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale) ou une IDEM (Inspectrice Départementale des Écoles Maternelles) et de son Conseiller Pédagogique. Ces journées commençaient souvent par une leçon-modèle assurée par un IMF (Instituteur Maître Formateur; à l’époque, cela devait s’appeler Maître d’Application), dans sa propre classe, avec ses propres élèves.
À l’issue de ces deux années, j’ai passé d’abord l’épreuve écrite du Certificat d’Aptitudes Pédagogiques, puis l’épreuve pratique, dans la classe de CM2 du directeur dans laquelle j’enseignais, à mi-temps, depuis la rentrée. Pendant l’autre mi-temps, j’avais les Petite Section de la directrice. Le directeur s’étant gardé l’enseignement des mathématiques, je ne peux pas vous dire ce que j’aurais reçu comme conseils de mon Conseiller Pédagogique qui est venu à de très nombreuses reprises pour m’épauler et me faire rentrer dans le cadre, cette année-là.
J’ai donc débuté à l’époque héroïque des mathématiques modernes. Je dois vous avouer qu’à part pendant la leçon-modèle d’un mercredi matin, dans la classe de Monsieur M., où nous avons vu des élèves de CM2 jongler avec les Mathcubes, je n’ai guère vu de classes qui appliquaient au pied de la lettre cette réforme.
En maternelle, c’était l’époque du no-number. Les élèves triaient, classaient, se repéraient dans un espace qu’ils organisaient de plus en plus précisément… Ils apprenaient à symboliser, à désigner, à se déplacer dans un labyrinthe, à coder un parcours, à continuer un algorithme répétitif et même récursif, en cours de GS, etc. Les blocs logiques de l’OCDL [Note du blogueur: maison d’édition scolaire] régnaient en maître et les enfants jouaient à les ranger par formes, couleurs, tailles et épaisseurs arrivant, en fin de GS, à combiner les quatre propriétés au cours d’un même jeu.
Au CP, nous avions le Touyarot [Note du blogueur: manuel]. Je dois encore en avoir un qui traîne quelque part. Quelques petites fiches sur les ensembles en début d’année, le temps de vérifier que nos élèves avaient compris l’utilité de la création d’une symbolique commune et qu’ils savaient déterminer puis respecter des critères de tri. Encore quelques-unes sur les différentes bases avant d’aborder la dizaine et l’alibi maths modernes était évacué. Les enfants continuaient par ailleurs à découvrir les nombres un à un, puis dizaine après dizaine lorsque nous avions dépassé 19, et à en faire le tour, comme dans l’article de Canac [Note du blogueur: Henri Canac, pédagogue des années 1940-1970, membre de la commission Langevin-Wallon, sous-directeur de l’ENS de Saint-Cloud] que j’ai redécouvert grâce à Rémi Brissiaud. Mais ils exploraient seulement le domaine additif, puisque la soustraction, la multiplication et la division avaient été évacuées du programme au cours des années précédentes.
Ce qui était le plus amusant, a posteriori, tant en maternelle qu’au CP, c’était le no-number obligatoire et les contorsions auxquelles cela nous contraignait. Nous ne devions arriver au nombre qu’après une longue période d’exercices de tris et de classement. Lorsque le critère de tri était la quantité, c’était après avoir procédé à une correspondance terme à terme par fléchage (bijection, c’est ça ?), les enfants devaient déterminer quelles étaient les collections égales ou organiser la relation d’ordre. Comme le Touyarot utilisait de toutes petites collections, les enfants disaient : « C’est elle ! Il y en a cinq dans cet ensemble et trois dans celui-là ! C’est « la cinq » qui gagne ! » et nous devions leur répondre que nous allions vérifier et qu’ils devaient tracer les petites flèches avant de placer leur symbole > ou <…
Dans les classes supérieures, c’était un peu la même chose, sauf dans les classes des Maîtres d’Application. Après un petit mois sacrifié aux ensembles et aux bases, les élèves reprenaient le chemin des trois opérations jusqu’en fin de CE2, puis des quatre à partir du CM1. Et lorsque nous arrivions pour un remplacement dans une classe de CM2, le programme suivi par l’instituteur ou l’institutrice ressemblait étonnamment à celui que nous avions suivi nous-mêmes huit à neuf ans plus tôt.
Nous les jeunes, nous déplorions bien fort cet état de fait et, si nous le pouvions, poussés par nos Conseillers Pédagogiques, nous sortions vite, vite nos blocs logiques et nos Mathcubes pour que, au moins pendant la durée de notre remplacement, les élèves aient droit à un bon enseignement des mathématiques !
Dès que j’ai eu une classe à moi, j’ai appliqué strictement le programme et la méthode, au moins pour les plus jeunes, ceux du CP. C’était une classe unique de village de 22 élèves. Je n’arrive pas à me rappeler ce que j’avais fait pour les plus grands. Il me semble qu’il y avait dans la classe des livres de mathématiques et que, n’ayant pas de machine à alcool, j’avais dû les garder et faire avancer les élèves page après page dans ces manuels qui devaient cependant obéir aux programmes de 1972, puisque ceux de français, dont je me souviens, y étaient conformes…
Deux ans plus tard, encore en classe unique, mais avec 5 élèves cette fois, je n’étais pas peu fière de pouvoir suivre enfin Ermel, le premier du nom ! [Note du blogueur: manuel produit par l’Equipe de recherches mathématiques a l’école élémentaire, pilotée par l’Institut national de recherche pédagogique] Ma jeune élève de CE1 comptait les additions, soustraction et multiplications à retenues en base quatre et cinq aussi bien qu’en base dix ! Qu’elle n’ait fait ni problèmes, ni géométrie de toute l’année n’effleurait pas la jeune femme de 21 ans que j’étais alors. Je suivais la méthode et le programme. Mes camarades de promotion et moi-même étions des pionniers et nous allions créer des mathématiciens là où nous, nous avions été déformés par un contexte trop balisé et une étude trop concrète de l’arithmétique. Mon sentiment d’imposture, encore lui, venait de mon hésitation à sauter le pas avec le grand, au CM1, en grande difficulté. Il avait commencé avec les vieilles méthodes et j’ai continué à lui baliser le terrain et à lui rendre concrets les exercices de calcul qu’il devait comprendre pour pouvoir envisager de suivre en 6ème dans un avenir assez proche.
Ce n’est qu’en 1987, dans une autre classe unique, que j’ai pu utiliser Ermel avec tous mes élèves, y compris avec mes quatre élèves de CM, dont mon fils. Ils en ont bouffé des arbres de tri, qui auraient dû les amener aux calculs de puissances, des segments partagés puis repartagés, en dix puis encore en dix puis encore en dix, qui auraient dû les conduire aux nombres décimaux… Et puis l’année avançait, et puis je lisais le programme (de 1986) et je voyais tout ce qui restait à faire et qu’ils n’avaient pas fait. Mais aussi, je l’entendais bien dire que ce Chevènement en demandait trop et que les élèves ne pouvaient pas ingurgiter tout cela ! Alors… J’étais toujours dans le camp du bien, du côté des I(D)EN puisque j’utilisais Ermel.
Cependant, l’année suivante, le remords me prit. Comme je savais au fond de moi que je n’étais qu’un vil imposteur, je décidai de prendre un manuel de mathématiques pour les élèves de CE et de CM. Entre temps, les bases avaient disparu et c’étaient les numérations égyptienne et maya qui les avaient remplacées. J’avais déjà Maths et Calcul (Eiller) au CE, je continuerais la collection jusqu’au CM2, ne gardant Ermel que pour les CP. Quand j’avais des maternelles, je ressortais les blocs logiques, les Mathœufs et les exercices de spatialisation, de topologie et d’organisation du temps.
En fin de CM2, nos élèves entraient en 6ème en sachant compter les quatre opérations dans l’ensemble des nombres décimaux, réduire des fractions au même dénominateur pour les ajouter et les soustraire, résoudre des problèmes à plusieurs étapes, portant sur la proportionnalité, les pourcentages, les moyennes, les aires, les volumes…
Cela nous mène en 1995, il me semble… Deuxième Ermel. Ah, les nombres reviennent en maternelle et au premier trimestre du CP ! La file numérique investit les tableaux. Je suis le nouveau programme et la nouvelle méthode… Nos petits ont droit au meilleur ! Les CP restent à l’addition. Les CE1 ne font plus que simplement découvrir les techniques opératoires de la soustraction et de la multiplication. La résolution de problèmes est à nouveau clairement indiquée dans le programme.
Parallèlement à cela, les programmes de Cycle 3 [CE2, CM1, CM2] dégraissent méchamment. La division par un décimal et les calculs sur les volumes et les durées disparaissent, la proportionnalité se réduit à des cas simples.
J’adopte un temps Objectif Calcul pour revenir rapidement à Ermel, très apprécié dans notre Académie. Ma collègue de Cycle 3 utilise Diagonale. Lorsqu’elle s’en va et est remplacée par de jeunes PE [Professeurs des écoles], tout juste sorties de l’IUFM, les élèves découvrent les joies d’Ermel, jusqu’au CM2. Ils comptent les trombones, découpent des bouts de rectangles pour trouver, en huit séances, quels sont les meilleurs outils pour tracer un angle droit, que sais-je encore… Ma jeune collègue me trouve ringarde parce que, en 2000, après un échec cuisant avec deux fillettes de CP qui, pendant toute l’année, n’ont pas réussi à entrer dans les mathématiques, je décide d’adopter le Brissiaud qui me semble plus carré, plus progressif, plus construit qu’Ermel. Je lis attentivement la préface, achète le livre du maître et suit le programme et la méthode avec application.
Ma jeune collègue s’en va. Une autre arrive. Elle adopte elle aussi J’apprends les maths [manuel de R. Brissiaud]. D’abord au CE2, puis jusqu’au CM2. Nous en sommes contentes. À part un élève de temps en temps, tout le monde avance, vite et bien.
Au CP et au CE1, la collection change après 2002. Zut ! Il manque des notions ! Déjà que je finissais le fichier de CP début mai et celui de CE1 début juin, qu’est-ce que ça va donner ? Les techniques opératoires sont toutes retardées… Mais pourquoi ? Les élèves y arrivaient bien, pourtant. Aaaaah ! En CE2, ils ont aussi supprimé beaucoup de choses : plus d’ateliers de résolution de problèmes abordant intuitivement les décimaux (euros et centimes, mètres et centimètres) et les fractions (pizzas à partager) dont mes élèves se régalaient… La technique de la soustraction a presque disparu du fichier CE1 remplacée par ces files de boîtes où Lola, mon élève lourdement dyslexique, se perd. Au CE2, la technique par cassage a remplacé celle par ajout d’une dizaine aux deux termes. Avec ma collègue, nous décidons de photocopier les pages de l’ancien fichier et de garder la technique traditionnelle. Je dispense Lola des files de boîtes, qui la perdent au lieu de l’aider, et remplace les pages de calcul réfléchi sur les valises, les boîtes et les billes par des pages de calcul réfléchi sur les nombres écrits en chiffres.
En 2005, après avoir lu sur internet les textes de Michel Delord et Rudolf Bkouche [Rappel du blogueur: Rudolf Bkouche, mathématicien, est membre du GRIP (Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes); Michel Delord est un ancien membre du GRIP.], je me dis qu’après tout, plutôt que de passer le troisième trimestre de CE1 à faire des révisions et à renforcer les compétences de mes élèves en techniques opératoires et en résolution de problèmes, j’aurais tout aussi vite fait d’adapter un de ces anciens manuels d’arithmétique et de voir ce que ça donne au bout d’une année de classe. Après tout, mon père et moi, les réputés non-matheux de la famille, avons survécu à ce régime et, si nous ne sommes ni l’un ni l’autre des mathématiciens hors-pairs, nous nous débrouillons finalement pas si mal et nous avons réussi dans notre vie à dominer et utiliser les nombres largement aussi bien (et même plutôt mieux, peut-être) que mes enfants nés en 1978 et 1981) !
Je gardais pour le moment mon Brissiaud au CP parce que là, je ne voyais vraiment pas comment faire autrement que ce qui était dit dans la préface de mon fichier ou dans le livre du maître, dont je ne me servais pas mais dont j’avais lu attentivement les pages d’argumentation. J’étais d’accord avec la méthode de M. Brissiaud, je ne vois pas pourquoi je l’aurais changée, même si je trouvais que mes élèves auraient pu aller bien plus loin dans la conceptualisation…
Je m’y mets donc et, en 2007, mes élèves nés en 2000 utilisent dans ma classe, la première version de ce qui va devenir deux ans plus tard le Compter Calculer au CE1 [Manuel édité par le GRIP]. Et, contrairement à ce qu’on m’avait raconté depuis trente et une années de classe… ça fonctionne ! Même avec les élèves en difficulté. Ce sont finalement les meilleurs qui souffrent un peu au début, coincés qu’ils sont par ce qu’ils ont appris en maternelle et dont ils n’arrivent pas à se dégager : le numérotage et sa copine la file numérique. Mais c’est surtout au CP que ce phénomène se produit et que je dois combattre durement contre les élèves qui confondent 13, 23 et 31. Le matériel de Picbille [lié au manuel de R. Brissiaud] m’y aide bien, le boulier de Gladys aussi. Au CE1, il ne reste souvent que quelques séquelles en numération [1], vite réglées par les exercices du Compter Calculer portant sur la monnaie et le système métrique.
Je présente donc mon travail à Michel Delord et aux autres membres du GRIP, dont Jean-Pierre Demailly, professeur de mathématiques à l’institut Fourier (Grenoble-I), membre de l’Académie des sciences [Note du blogueur: Jean-Pierre Demailly est président du GRIP]. Ils sont enthousiastes. Mes collègues professeurs des écoles tempèrent un peu leurs ardeurs. Le manuel est trop fourni, il va trop loin (nombres jusqu’aux centaines de mille, multiplications à deux chiffres au multiplicateur, bénéfices, pertes, salaires…). Nos élèves n’ont plus que 24 heures de classe par semaine, ils ne peuvent fournir le travail que fournissaient des élèves ayant eu 30 heures de classe depuis la maternelle ! Et puis, il faut penser à ceux qui n’ont pas fait grand-chose d’autre que de la lecture de nombres et des additions au CP… Pour ceux-là, même si le manuel reprend tout presque à zéro (les nombres de 1 à 9) et installe pas à pas les notions, cela risque fort d’être trop ardu.
À nous tous, nous élaguons, nous réorganisons, nous remanions. Certains d’entre eux commencent à utiliser la version de travail dans leurs classes… Cela fonctionne aussi chez eux. Alors, plus d’hésitation, nous éditons !
En même temps, avec un peu d’angoisse, mais parce que, décidément, choisir entre faire cinq à quinze minutes de mathématiques à l’écrit par jour au CP ou finir le fichier entre la mi-mars et la mi-avril, ça n’est pas satisfaisant, j’abandonne le Brissiaud. Je garde cependant la résolution d’y revenir si Compter Calculer au CP ne me donne pas satisfaction. J’ai même eu dans l’idée un moment d’écrire au père du célèbre Picbille pour lui demander pourquoi il a réduit ainsi ses ambitions jusqu’à repousser l’étude de la technique opératoire de l’addition à l’avant-avant-dernière leçon de son fichier de CP. Et puis je n’ose pas parce que c’est un grand monsieur qui fait des colloques et moi, une PE de base qui fait les choses comme elle les sent, à l’intuitif, et selon ce qu’elle voit, au jour le jour, année après année, dans sa classe du fin fond de la campagne.
Finalement, le Compter Calculer au CP [manuel du GRIP] a si bien convenu à mes élèves que j’ai décidé de formaliser le matériel que j’utilisais en GS depuis des années en lui donnant un petit frère que mon amie Sophie Wiktor a illustré avec talent. J’ai introduit les nombres et le calcul, façon H. Canac, au programme que faisaient mes petits élèves des années 80 (repérage dans l’espace, repérage dans le temps, tris et comparaisons de formes et de grandeurs, symbolisation). Mes GS s’en régalent depuis trois ans maintenant après s’être régalés, un peu moins, avec mes horribles gribouillages des années précédentes.
Alors oui, sans doute que je commets énormément d’erreurs. Mais pas plus que lorsque je suivais au pied de la lettre ce qu’on me disait de faire pour le bien de mes élèves. Sans doute aussi que mon microclimat ne résiste pas aux enfants qui, à quatre ans, ne parlaient pas encore et ont cumulé au-dessus de leurs berceaux toutes les difficultés, mais il n’y réussissait pas non plus lorsque j’utilisais la méthode et le programme conseillés par la mode du moment.
Je n’ai toujours pas 100 % de réussite, cela est vrai. Et, comme avec les autres méthodes, y compris l’ami Picbille, dans ma classe, certains enfants prennent la solution du raccourci le moins pénible en branchant ce que j’ai appelé le pilote automatique. Cependant les autres me donnent réellement l’impression d’avoir la ferme intention d’apprendre à piloter eux-mêmes leur apprentissage des mathématiques et d’y réussir [2].
D’ailleurs, ma collègue a été peu à peu obligée d’abandonner elle aussi les Brissiaud parce que ses élèves les avalaient trop vite. L’an dernier, sa fournée de CM (8 CM2 et 10 CM1) a utilisé pour la première fois le manuel Compter Calculer au CM1, les plus âgés après un an de À portée de maths CM1, les plus jeunes après un an de Compter Calculer au CE2. Je suis au regret d’être obligée d’à nouveau montrer ma satisfaction, mais nous avons constaté que c’étaient les plus jeunes qui réussissaient le mieux les problèmes mélangés d’addition, de soustraction, de multiplication, de division, à plusieurs étapes. Et pourtant, les grands étaient d’un bon niveau puisqu’aux évaluations nationales réputées très difficiles, ils ont tous dépassé les 66 % de réussite en mathématiques et que cette année, en 6ème, ils ont eu au premier trimestre des moyennes de maths s’étalant entre 13/20 pour la plus faible et plus de 18/20 pour les cinq meilleurs.
Enfin je viens d’apprendre tout récemment, par un bruit de couloir, le reproche que notre population de parents d’élèves nous fait… Figurez-vous que nous emmenons nos élèves trop loin et que, par notre faute, ils n’apprennent pas au collège la valeur de l’effort puisque, pendant leur année de 6ème, ils peuvent briller sans rien apprendre !
[1] « Treize, est-ce une dizaine et trois unités ou trois dizaines et une unité ? A moins que ce soit une unité et trois unités ou encore une dizaine et trois dizaines ?… » À pleurer !
[2] Hier, ceux-là (CE1) ont tous résolu le problème « Combien de billets de 100 € pour payer 4 800 € ? ». Les uns (1/3 environ) par le calcul en ligne « 4 800 : 100 = 48 », les autres par additions réitérées après avoir précisé que 1000 €, c’étaient 10 billets de 100 €. Et lors du contrôle de fin de période, ils ont bien entendu réussi les problèmes mélangés d’addition, de soustraction, de multiplication et de division qu’ils devaient y résoudre.
Rédigé par : Catherine Huby | le 01 mars 2014 à 18:42 |
Acte 4. Scène 2. Rémi Brissiaud à Catherine Huby
Bonjour Madame Huby,
Aux États-Unis, il est extrêmement fréquent que les auteurs de méthodes mettent en avant des témoignages d’utilisateurs ainsi que des évaluations menées en interne. Si je souhaitais le faire, je pourrais vous faire parvenir des lettres de parents demandant s’il existe des ouvrages permettant de poursuivre au collège le travail que leur enfant a commencé avec les nôtres (j’associe tous les enseignants qui ont travaillé avec moi), je pourrais évoquer que dans les classes expérimentales, en fin de CM1, 75% des élèves réussissaient la tâche suivante :
Lequel de ces deux nombres est le plus proche de 7 : est-ce 6,9 ou 7,08 ?
Vous avez bien lu : 75% de réussite au CM1 alors que d’autres évaluations rapportent seulement 29% de réussite en 5e de collège. Je pourrais agiter la fibre démocratique en vous disant que le même taux de réussite s’observait dans des classes de mon « 9-5 », des classes situées à Sarcelles, par exemple.
Je ne le ferai pas ou, plus exactement, je ne le ferai pas plus que je ne viens de le faire. La raison : on n’a pas suffisamment de certitude que de telles réussites se retrouveront chez d’autres utilisateurs. De telles données ne sont pas récoltées dans des conditions qui permettent de les interpréter de manière univoque. Il y a, de plus, l’effet expérimentation. Et concernant la pérennité de bons résultats éventuels, il y a l’effet inverse, l’obsolescence des leçons : une même séquence, menée par le même maître plusieurs années de suite voit son efficacité se dégrader. Il y a surtout la compréhension par l’utilisateur des raisons pour lesquelles il s’y prend ainsi. Sans une telle compréhension, les dysfonctionnements sont nombreux.
Pour tendre vers la meilleure reproductibilité possible, je préfère mettre en avant les raisons des choix correspondants à telle ou telle progression que nous avons élaborée. Concernant les décimaux-fractions, par exemple : pourquoi nous préférons introduire d’abord les fractions décimales en les notant avec des barres de fractions, et adopter la notation avec la virgule dans un deuxième temps seulement, pourquoi nous choisissons de n’utiliser cette notation avec la virgule que lorsque les élèves ont une bonne maîtrise du maniement des unités, des dixièmes et des centièmes sous forme fractionnaire, pourquoi nous choisissons d’introduire les notations fractionnaires alors qu’elles ont un sens de division (c’est une nouvelle division où l’on partage le reste), etc.
Oui, je crois qu’il faut d’abord mettre les raisons en avant. C’est ce qui frappe dans le parcours professionnel que vous décrivez : longtemps, vous semblez accepter de vous couler dans un moule sans savoir pourquoi il a telle forme plutôt que telle autre. Et lorsqu’on s’intéresse à la rationalité de vos choix successifs, on tombe sur un surprenant :
“J’étais toujours dans le camp du bien, du côté des I(D)EN puisque j’utilisais Ermel”
Et il a fallu que vous alliez dans le camp du mal, d’abord avec mes ouvrages puis avec les vôtres, pour qu’enfin on ait le sentiment que vous cherchez à mettre des raisons sur vos choix.
Tout ça n’est guère glorieux pour l’institution, évidemment, mais cela devrait également vous mettre en garde : ne vous considérez pas comme arrivée dans le « vrai » camp du bien, argumentez patiemment sur les raisons qui vous conduisent à penser qu’il vaut mieux faire comme ça plutôt que comme ça, faites-le autrement qu’en convoquant la foi en des résultats qui ne seront pas nécessairement au rendez-vous chez les utilisateurs de votre méthode. Et évitez de dire que vous n’êtes qu’ « une PE de base qui fait les choses comme elle les sent, à l’intuitif, et selon ce qu’elle voit, au jour le jour, année après année. » Vous savez que ce n’est pas le cas. Certains de vos lecteurs risquent de vous suivre dans cette apologie du PE qui ne fonctionnerait qu’à l’instinct. Je pense que ce n’est pas ce que vous souhaitez.
Bien cordialement,
Rédigé par : Remi Brissiaud | le 05 mars 2014 à 08:30 |
Acte 4. Scène 3. Pascal Dupré à Rémi Brissiaud
[Note du blogueur: Pascal Dupré est un enseignant du primaire membre du GRIP et participant à l’expérimentation SLECC (Savoir lire, écrire, compter, calculer). Il fait partie de ces enseignants auxquels j’avais rendu visite en 2006 pour une enquête du Monde de l’Education sur cette expérimentation. L.C.]
« Certains de vos lecteurs risquent de vous suivre dans cette apologie du PE qui ne fonctionnerait qu’à l’instinct. Je pense que ce n’est pas ce que vous souhaitez. » Bien sûr monsieur Brissiaud, ce n’est pas ce que souhaite Catherine Huby. N’essayez pas de nous resservir la vieille opposition « praticiens vs théoriciens », Catherine a évoqué ses rencontres et ses discussions avec Delord, Bkouche et Demailly. Si elle met en avant son expérience professionnelle, son « instinct », son « bon sens », c’est que les instituteurs de notre génération ont vu ces vertus bafouées, d’inspections en conférences pédagogiques, tombant de Charmeux en Charnay.
[Note du blogueur: Eveline Charmeux, née en 1932, a été chercheur à l’INRP et professeur à l’IUFM de Toulouse. Concernant l’apprentissage de la lecture, elle défend avec Foucambert le principe, aujourd’hui extrêmement minoritaire, selon lequel «c’est par le message qu’on accède au code». Roland Charnay est un didacticien des mathématiques ayant participé à l’élaboration des programmes du primaire de 2002. LC.]
Oui, nous appartenons à une génération qui a douté et qui s’est remise en question sous les coups des sciences de l’éducation. Mais quand nous avons rencontré les travaux des mathématiciens cités précédemment (et bien d’autres, puisque vous appréciez les références : Laurent Lafforgue, Klaus Hoechsmann, Ralph Raimi, Ron Aharoni … ) nous avons acquis des certitudes confortant nos expériences professionnelles et le sentiment d’avoir été trompés et peut être même trahis. Luc Cédelle va sans doute brandir sa pancarte « trahison des clercs » = « théorie du complot », mais le titre de son billet [Puisque «l’école n’enseigne plus», à quoi bon la conserver?] n’est-il qu’une pirouette journalistique ou aborde-t-il une vraie question à laquelle il faudra bien répondre un jour ?
Pascal Dupré
PS : pour ce qui est de la critique du titre de nos ouvrages « Compter Calculer », je trouve que vous avez une vision bien réductrice du comptage.
Rédigé par : Pascal Dupré | le 06 mars 2014 à 09:25 |
Acte 4. Scène 4. Luc Cédelle à Pascal Dupré
Non, cher Pascal Dupré. Je ne « brandis » pas ma « pancarte ». Je ne « crie » pas à la « trahison » et, tant qu’on y est, je peux même me passer des guillemets qui suggèrent une intonation sarcastique. Bref, j’observe avec intérêt. Et patience. J’observe des politesses, de vraies discussions responsables, sérieuses, étayées… et çà et là, quelques tentations nostalgiques du bon vieux temps de la castagne. LC
Rédigé par : education | le 06 mars 2014 à 12:02 |
Acte 4. Scène 5. Rudolf Bkouche à tous
Si l’école d’aujourd’hui se proposait d’instruire, elle ne proposerait pas des programmes de mathématiques indigents et parfois faux. L’histoire des programmes de mathématiques, depuis Chevènement pour être précis, me conduit à poser la question : pourquoi cette incohérence ? Je parle de la discipline que j’ai enseignée mais je pense que c’est aussi vrai ailleurs.
Rédigé par : rudolf bkouche | le 06 mars 2014 à 13:35 |

Acte 4. Scène 6. Catherine Huby à Rémi Brissiaud
Bonjour Monsieur Brissiaud,
Je suis comme vous persuadée de la nécessité de mettre en avant les raisons de nos choix méthodologiques si l’on veut s’assurer de la plus grande reproductibilité possible.
N’étant malheureusement pas qualifiée pour expliquer avec les termes qui conviennent le fondement mathématique des choix que nous avons faits en mettant au point la collection Compter-Calculer, je me suis permis de vous renvoyer vers les mathématiciens qui les ont exposés ici ou là : Jean-Pierre Demailly, Rudolf Bkouche, Isabelle Voltaire, Michel Delord…
Bien sûr que, du haut de mes dix-huit ans, lorsque mes formateurs m’assuraient main sur le cœur que grâce à ces méthodes nouvelles j’allais créer l’homme nouveau, je les croyais. On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, disait Rimbaud, et je n’avais qu’une année de plus…
Depuis, j’ai vieilli et, comme le dit une intervenante, qui n’est pas PE, sur mon blog, [début de citation]« ce n’est qu’aux abords de la cinquantaine qu’on commence à bien se libérer de ces influences. Et encore [ai-je] eu la chance d’exercer dans de toutes petites écoles, suivant les élèves plusieurs années de suite, ce qui [m’a] laissée plus libre, moins influencée et plus à même de [me] forger une opinion libre et un outil de travail à [mon] goût.
A cet âge, on passe pour de vieux imbéciles encroûtés et il est bien difficile de convaincre les jeunes de l’efficience de notre mode de fonctionnement. Ils n’y croient pas car tout, jusqu’aux cours qui leur ont été dispensés usaient de l’habileté démoniaque du publireportage qui est affublé de tous les oripeaux de la science pure vraie et libre, progressiste, dissimulant avec une habileté de plus en plus efficiente la part de publicité pure. On n’y voit que du feu, quand on a vingt, trente ou quarante ans et qu’on a le désir de bouger, d’aller de l’avant, de progresser. On pense faire mieux en se tenant au courant des nouveautés, en les adoptant et en s’y mettant à fond. » [fin de citation]
Je vous remercie de me mettre en garde contre une crise éventuelle de « grosse tête » assortie de « chevilles enflées ». Ne vous inquiétez pas, j’ai toujours un élève par ci par là qui s’en charge. Lorsque je vois défiler les tracteurs en rangs serrés dans ses yeux ébahis après que j’ai mené une séance de découverte qui me semblait pourtant parfaitement réussie, je me rends bien compte toute seule de mon insuffisance !
Je suis sincèrement désolée du tour que prend notre conversation et j’ai bien peur d’avoir été un peu trop directe. J’aurais tant voulu que nous dialoguions sans animosité.
Ces dernières années, j’ai en effet diffusé le plus largement possible autour de moi dans ma profession vos arguments contre la file numérique et le numérotage. Ils correspondaient si bien à ce que mes collègues PE utilisant les manuels SLECC [Savoir lire, écrire, compter, calculer; il s’agit de l’expérimentation menée par le GRIP dans quelques dizaines de classes] et moi-même avions constaté dans nos classes !
Encore l’an dernier, en émettant à voix haute mes doutes et vos certitudes sur cette fichue « file numérique », je me suis fait mal voir de toute une salle de professeurs des écoles de Grande Section et de Cours Préparatoire ainsi que de la CPC (conseillère pédagogique de circonscription) et de la PEMF (professeur des écoles maître formatrice) qui animaient la demi-journée de réflexion.
Et j’ai aggravé mon cas en parlant du travail de calcul sur les petits nombres, votre article paru dans Fenêtres sur Cours [magazine du Snuipp-FSU, syndicat du primaire] à l’appui !
De leur avis, j’étais folle et ce n’était pas au programme de la Grande Section contrairement au dénombrement qui, quoi que je dise et quoi que disent la plupart des instits de CP présents, était fort utile et indispensable à la construction du nombre par l’enfant !
C’est aussi pour cela que cette année, lorsque vous avez parlé d’Henri Canac sur le site des Cahiers Pédagogiques, je me suis empressée de chercher l’article dont vous parliez et de le diffuser, en plusieurs extraits afin de permettre à des collègues pressés d’avoir le temps de se l’approprier.
[Note du blogueur. En fait l’article qu’évoque Catherine Huby a été publié en novembre 2012 par le Café pédagogique, et non par les Cahiers. Sur le site du Café, c’est un article long, introduisant bien au débat qui se poursuit actuellement, notamment ici, et que ceux qui ne sont pas rebutés par le sujet ni par un effort supplémentaire auront profit à lire. Les Cahiers pédagogiques ont par ailleurs publié en juin 2012 un article de Rémi Brissiaud intitulé L’enseignement du comptage en débat. LC.]
Je reste persuadée, malgré vos dénégations polies dont je vous remercie, d’être une PE de base. Peut-être à l’ancienne mode, celle des Écoles Normales, des IDEN et de leurs Conseillers Pédagogiques qui venaient pour aider, apprendre et réconforter, et non pour évaluer et pondre des rapports, mais une PE de base quand même, qui cherche constamment ce qui pourra être le meilleur et le plus efficient pour ses élèves, et tout particulièrement pour les moins favorisés d’entre eux.
Cordialement,
Catherine Huby
Rédigé par : Catherine Huby | le 06 mars 2014 à 10:05 |
Acte 4. Scène 7. Luc Cédelle à Catherine Huby
Non, chère Catherine Huby, vous n’avez pas à être désolée du ton que prend votre conversation avec Rémi Brissiaud qui, comme tout le monde ici peut le constater, s’exprime sans « animosité » à votre égard. Un échange d’arguments ne relève pas du manque de considération, même si vous pouvez ponctuellement vous irriter de telle ou telle interpellation ou remarque. LC
Rédigé par : education | le 06 mars 2014 à 12:08 |
Acte 4. Scène 8. Michel Delord à tous
Bonjour,
Toujours un petit peu en retard par rapport à mes plans de publication, j’essaie de les adapter aux discussions en cours.
Donc récemment* – précisément le 06 mars 2014 à 10:05 – Catherine Huby a écrit :
« Ces dernières années, j’ai en effet diffusé le plus largement possible autour de moi dans ma profession vos arguments contre la file numérique et le numérotage. Ils correspondaient si bien à ce que mes collègues PE utilisant les manuels SLECC et moi-même avions constaté dans nos classes ! »
Elle diffuse donc bien et largement « les arguments de Rémi Brissiaud contre la file numérique et le numérotage ».
Je trouve personnellement que les arguments de Rémi Brissiaud qui ne sont certes pas sans valeur sont plus que partiellement inadéquats et même dangereux si on les répète sans voir leurs conséquences. C’est ce que j’avais expliqué dans un texte qui a maintenant plus de quatre mois puisqu’il est paru sur ce blog le 25 octobre 2013. Il mettait en cause la position de Rémi Brissiaud et ce qui me semblait être un soutien sans critique de la part de Catherine Huby. Et effectivement ce soutien s’est bien révélé être un soutien sans critique puisque ce n’est pas seulement Catherine Huby mais le GRIP qui n’a fait aucune critique explicite des positions de Rémi Brissiaud.
Et de plus mon texte n’a eu aucune réponse ni de la part de C. Huby ni du GRIP. Et l’on ne peut invoquer comme raison de cette non-réponse une difficulté théorique puisque, à part la note 9 dont le contenu n’est pas nécessaire pour la compréhension du texte, il ne parle que de nombre ordinal, nombre cardinal, comptage et calcul, adjectif numéral, adjectif cardinal et ceci à un niveau qui ne dépasse pas, en gros, le niveau d’entrée à l’Ecole normale en 1960.
Il semble donc impossible pour le moment et après quatre mois d’en discuter avec le GRIP.
Mais il sera peut-être possible de le faire avec Rémi Brissiaud. Et ce d’autant plus que ce texte d’octobre dernier n’est que la première partie d’un texte beaucoup plus complet qui a plus que doublé de volume et qui devrait paraitre incessamment sous peu.
Michel Delord
Rédigé par : Michel Delord | le 07 mars 2014 à 08:51 |
Acte 4. Scène 9. Julien Giacomoni à Michel Delord
[Julien Giacomoni, professeur agrégé de mathématiques, est co-secrétaire du GRIP]
Salut Michel,
Comme toujours tu écris un texte qui apporte publiquement un éclairage théorique crucial, sur les contenus et sur leur enseignement.
Tu dis: « Allons tout de suite à la question théoriquement centrale… ». J’ai bien peur qu’en l’occurrence la dérive dont témoigne Catherine (et ce qu’elle dénonce) est une réalité dans laquelle les pratiques sont déconnectées de tout aspect théorique mathématique.
Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que la question de fond est plus profonde et absolument pas récente.
Bien cordialement,
Julien Giacomoni
Rédigé par : Julien Giacomoni | le 07 mars 2014 à 16:27 |
Acte 4. Scène 10. Rudolf Bkouche à tous
Pour préciser, je dirai que je ne comprends pas cette distinction entre numérotation et dénombrement. Pour dénombrer on compte. Mais le comptage consiste à compter des objets et on met en relation l’ensemble des objets avec la comptine. Effectivement, on mélange ici cardinaux et ordinaux, mais peut-on faire autrement. Cette distinction ne peut venir qu’après.
C’est bien parce que l’on compte qu’on acquiert la notion de nombre.
On sait que cela ne suffit pas et qu’il faut aller plus loin. D’abord on calcule et plus tard on peut lire Frege, Peano et Dedekind.
Il y a encore ici chez Brissiaud une peur de l’empirisme comme si on pouvait acquérir d’un seul coup une connaissance complète des nombres, mais c’est quoi une connaissance complète des nombres.
On sait qu’il y a deux modes de construction axiomatique des nombres, celle de Peano et celle de Dedekind qui s’appuie sur la notion d’ensemble. Alors on aimerait raconter cela aux petits-enfants, ce qui aurait un effet immédiat : les petits enfants ne sauront pas compter.
La distinction posée par Brissiaud, aussi intéressante soit-elle, ne présente aucun intérêt dans l’apprentissage du comptage. Ici encore, comme souvent les théoriciens de l’apprentissage confondent l’apprentissage du comptage et l’analyse de la notion de nombre. On peut alors poser, par provocation,la question de savoir si ce sont les nombres qui définissent le comptage ou si c’est le comptage qui définit les nombres ; c’est le problème de la poule et de l’œuf.
Rédigé par : rbkoucje@wanadoo.fr | le 07 mars 2014 à 14:29 |
 [Récapitulatif du blogueur. Sur la fin de cet épisode, le dialogue tourne au froid. Mais d’une part cette fin est artificielle et d’autre part débattre ne signifie pas écraser les contradictions mais les mettre en lumière. Nous y reviendrons donc. A propos de mise en lumière, il faut remarquer que le chercheur Rémi Brissiaud avait déjà, ces derniers mois, notamment à plusieurs reprises sur le Café pédagogique, développé ses positions sur le comptage, son analyse sur la baisse des performances en calcul et plus récemment sa perception critique des interprétations médiatiquement dominantes de Pisa. Plus récemment, il avait fait de même dans l’émission de Louise Tourret sur France Culture, Rue des écoles. S’agissant d’une personnalité connue dans le milieu, on pouvait penser que cela allait forcément défrayer la chronique, à la façon dont certains magazines nous ont habitués à traiter des questions scolaires, du genre « Enseignement du calcul : le dossier qui accuse » ou « Ce que Pisa ne nous dit pas »… Et en fait, non. Comme s’il était bon de marteler sans fin le refrain simplifié et outrancier de la débâcle, et mauvais de s’interroger sur de possibles causes de dégradation, dès lors qu’elles ne sont pas réductibles à des slogans. Ou alors, plus innocemment, est-ce un effet du blocage des littéraires, majoritaires dans les médias, face à des questions qui les terrorisent (je fais partie des terrorisés)? C’est une hypothèse. Quoiqu’il en soit, cela prouve qu’il faut insister. Une dernière chose: je ne sais pas qui, de Brissiaud, ou Delord, ou d’autres qui comptent et ne prennent pas part au présent échange, a raison dans cette affaire. En revanche, il m’apparaît que les avis ici exprimés sont tout à fait dignes de considération, qu’ils respectent dans l’ensemble une certaine éthique du débat, et que des discours beaucoup moins élaborés sont fréquemment portés au pinacle. L.C.]
[Récapitulatif du blogueur. Sur la fin de cet épisode, le dialogue tourne au froid. Mais d’une part cette fin est artificielle et d’autre part débattre ne signifie pas écraser les contradictions mais les mettre en lumière. Nous y reviendrons donc. A propos de mise en lumière, il faut remarquer que le chercheur Rémi Brissiaud avait déjà, ces derniers mois, notamment à plusieurs reprises sur le Café pédagogique, développé ses positions sur le comptage, son analyse sur la baisse des performances en calcul et plus récemment sa perception critique des interprétations médiatiquement dominantes de Pisa. Plus récemment, il avait fait de même dans l’émission de Louise Tourret sur France Culture, Rue des écoles. S’agissant d’une personnalité connue dans le milieu, on pouvait penser que cela allait forcément défrayer la chronique, à la façon dont certains magazines nous ont habitués à traiter des questions scolaires, du genre « Enseignement du calcul : le dossier qui accuse » ou « Ce que Pisa ne nous dit pas »… Et en fait, non. Comme s’il était bon de marteler sans fin le refrain simplifié et outrancier de la débâcle, et mauvais de s’interroger sur de possibles causes de dégradation, dès lors qu’elles ne sont pas réductibles à des slogans. Ou alors, plus innocemment, est-ce un effet du blocage des littéraires, majoritaires dans les médias, face à des questions qui les terrorisent (je fais partie des terrorisés)? C’est une hypothèse. Quoiqu’il en soit, cela prouve qu’il faut insister. Une dernière chose: je ne sais pas qui, de Brissiaud, ou Delord, ou d’autres qui comptent et ne prennent pas part au présent échange, a raison dans cette affaire. En revanche, il m’apparaît que les avis ici exprimés sont tout à fait dignes de considération, qu’ils respectent dans l’ensemble une certaine éthique du débat, et que des discours beaucoup moins élaborés sont fréquemment portés au pinacle. L.C.]
A suivre..
Pour revenir à l’Acte 1, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 2, cliquer ici
Pour revenir à l’Acte 3, cliquer ici
 En février-mars 2014, je m’étais lancé (et j’avais tenu jusqu’au bout…) dans une très aventureuse série de billets de blog mettant en scène le débat sur le niveau des élèves de primaire en mathématiques, à partir de précédents échanges sur mon blog. Ce débat, comme tous les débats liés à l’éducation, ressurgit à l’occasion de la publication de l’enquête TIMSS. Pour celles et ceux que cela intéresse, voici le récapitulatif que j’en faisais… ainsi, ce qui est plus important, les liens sur les différents billets de la série. L.C.
En février-mars 2014, je m’étais lancé (et j’avais tenu jusqu’au bout…) dans une très aventureuse série de billets de blog mettant en scène le débat sur le niveau des élèves de primaire en mathématiques, à partir de précédents échanges sur mon blog. Ce débat, comme tous les débats liés à l’éducation, ressurgit à l’occasion de la publication de l’enquête TIMSS. Pour celles et ceux que cela intéresse, voici le récapitulatif que j’en faisais… ainsi, ce qui est plus important, les liens sur les différents billets de la série. L.C.